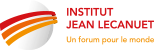Les nouvelles sociétés du savoir : pourquoi ? où ? comment ?
Articles de la revue France Forum
A l'issue de la première table ronde de la conférence "Sociétés du savoir : partage ou partition ?", les intervenants ont répondu aux questions de la salle.
ARMELLE LÉVY. – Jean-Michel Blanquer, aujourd’hui l’information est partout, à portée de main, les étudiants recourent fréquemment au copier-coller. Qu’en pensez-vous ?
JEAN-MICHEL BLANQUER. – Une idée fréquemment formulée postule que, l’ensemble des informations étant présentes sur Internet, il ne serait plus nécessaire d’apprendre. Au contraire, nous devons être capables de débattre sans recourir à Wikipédia.
Le risque, dans une civilisation de l’hypertexte, est de répéter des discours qui nous traversent, mais que nous n’avons pas formulés nous-mêmes. ce serait alors le contraire de la liberté. Notre philosophie de l’éducation doit consister à fournir aux enfants un socle de culture générale qui leur permette d’interpréter le monde.
L’enjeu est de concilier la transmission d’un socle commun tout en assurant une personnalisation des parcours, du fait de la diversité des intelligences et des capacités. Les nouvelles technologies rendent possibles cela. La France reste, hélas, méfiante à l’égard de cette personnalisation, susceptible de favoriser l’exclusion et la sélection précoce, alors que l’objectif est justement inverse. Nous devons apporter dès le départ le maximum à chaque enfant, puis à chacun selon ses besoins, pour compenser des faiblesses ou encourager des excellences.
ARMELLE LÉVY. – Roger-François Gauthier, incluez-vous la dictée dans vos considérations sur la nostalgie et la routine empêchant toute réflexion sur l’évolution des savoirs ?
ROGER-FRANÇOIS GAUTHIER. – Nous sommes tous nostalgiques de certains aspects de l’éducation reçue, quand ils portent, pour certains d’entre nous, le parfum de l’enfance. Mais cela ne doit pas empêcher de penser au-delà, sinon on n’enseignerait guère que les astuces pour tailler des silex bifaces…
Par exemple, nous listons traditionnellement parmi les fondamentaux le fait de lire, écrire et compter. Pourquoi le fait de parler et d’apprendre à vivre avec les autres n’est-il pas pris en compte ? Ne sont-ce pas des fondamentaux ? Certaines habitudes de pensée doivent être dépassées.
L’irresponsabilité de nos savoirs réside également dans une définition nationale et centralisée, niant la nécessité d’un travail à mener sur les savoirs dans chaque établissement scolaire. Dans d’autres pays, les grandes lignes sont certes fixées à l’échelon national, de façon très forte, mais il revient aux établissements de mettre en oeuvre concrètement ces exigences et de les adapter le mieux possible aux élèves de l’établissement. En France, les syndicats d’enseignants s’opposent majoritairement à une telle évolution et éludent la question de l’autonomie des établissements scolaires. néanmoins, nous ne pourrons pas refuser sur le long terme une telle évolution, nécessairement bénéfique aux élèves.
Autre exemple : le système d’examen et d’évaluation fonctionne et les ministres se félicitent de l’amélioration des résultats au baccalauréat chaque année. Toutefois, personne n’aborde la question de savoir ce que mesure un baccalauréat et ce que prouve le succès d’un candidat. Il est, en réalité, irresponsable, là encore, de considérer que les savoirs appris à l’école ont pour seule fonction de réussir des examens et des concours. Dans le système actuel, la question du fond des savoirs transmis apparaît presque secondaire et l’on ne peut que le regretter.
ARMELLE LÉVY. – J’ai remarqué des désaccords entre Jean-Michel Blanquer et vous sur les programmes. Souhaitez- vous préciser votre pensée ?
JEAN-MICHEL BLANQUER. – Les désaccords sont nécessaires ! Je partage l’avis de Roger-François Gauthier sur un certain nombre de points, dont celui de la pédagogie explicite, avec la nécessité d’expliquer la finalité de l’enseignement. En revanche, l’abstraction ne correspond pas nécessairement à un éloignement de la vie. Cette abstraction a, au cours de l’histoire scolaire française, représenté une des vertus de notre système. Elle demeure une force, il suffit pour s’en convaincre de regarder le succès des lycées français à l’étranger. Les programmes, peut-être abstraits, proposent néanmoins une logique et une cohérence appréciées dans un monde de l’immédiateté. La France reste d’ailleurs un leader mondial dans le domaine des mathématiques : il faut s’en réjouir ! L’enfant doit, bien sûr, s’ancrer dans la vie, mais devrait être confronté à l’abstraction dès son plus jeune âge. Son rejet risque d’accentuer les inégalités en limitant son accès à certaines classes sociales. La première abstraction reste d’ailleurs la lecture, par la capacité à relier les syllabes. La lutte contre l’abstraction peut représenter un danger, tandis que l’école de la vie peut mener à l’école de l’abstraction.
ROGER-FRANÇOIS GAUTHIER. – Le problème réside dans l’excès d’abstraction qui peut déstabiliser les élèves, mais l’abstraction constitue, bien entendu, un objectif intellectuel. La position humaine à favoriser chez les élèves est, au fond, celle d’allers-retours entre la vie, qui est à vivre, et l’abstraction, qui permet de se hisser au point d’où on comprend le monde.
JEAN-JACQUES SLOTINE. – En France, le niveau en mathématiques, qui jusqu’à récemment était une force, régresse considérablement du fait d’une réduction du nombre d’heures accordées à cette discipline. Les grandes écoles scientifiques ont longtemps été un ascenseur social ; elles ont perdu cette capacité et les statistiques montrent que leurs étudiants sont principalement issus des milieux aisés. Sur le sujet des sciences cognitives, des enseignements importants pour la transmission des savoirs seront apportés dans les années à venir.
ARMELLE LÉVY. – N’existe-t-il pas, avec les Mooc et le mouvement de dématérialisation, un risque de perte de l’humain, puisqu’on démultiplie les interfaces ?
THIERRY HAPPE. – Chaque étudiant souhaite certainement intégrer une grande école ou une université. Lorsqu’il n’en a pas les moyens, pouvoir, malgré tout, accéder aux meilleurs cours et parfois d’être certifié par des systèmes d’évaluation comme Coursera représente une avancée remarquable. Plus la dématérialisation est prégnante, plus les contacts humains sont essentiels et de qualité supérieure. Cette remarque est valable pour tous les usages du digital. Les applications les plus téléchargées sont des outils d’intermédiation pour faciliter les rencontres personnelles. Dans le domaine de l’éducation, le numérique ne peut se passer de la dimension humaine.
ARMELLE LÉVY. – La France perd des places dans les classements internationaux. Que peuvent vraiment apporter dans la mondialisation, les savoirs et le savoir-faire français ?
JEAN-MICHEL BLANQUER. – En visite à Paris en novembre dernier, le vice-Premier ministre de Singapour, ancien ministre de l’éducation, dont le pays figure la plupart du temps en tête des classements internationaux, s’est intéressé à la formation continue proposée par l’Essec Business School. Malgré les bons résultats de son pays en matière éducative, il cherche toujours à améliorer son système national et le compare en permanence aux pratiques d’autres pays. Cette démarche, d’une grande humilité, traduit un besoin constant de remise en question pour progresser. Par la suite, au cours des premières rencontres économiques France-Singapour organisées sur le campus de l’Essec à Singapour, des participants singapouriens ont souligné la qualité de nos diplômés, leur créativité et leur french flair. Les compétences en mathématiques et en sciences, associées à cette inventivité, constituent une force incontestable de la France du point de vue de l’étranger. nous devons préserver cet atout et le développer en nous ouvrant à la comparaison internationale.
DE LA SALLE. – Au regard des classements des pays asiatiques, comment expliquer que les performances en matière de savoir puissent naître majoritairement dans des pays non démocratiques ?
BENOÎT VERMANDER. – Le savoir en tant que savoir est indépendant des conditions politiques. La question est plutôt de comprendre comment il est assimilé et mobilisé et de voir si un type spécifique de connaissances (connaissances purement techniques, par exemple) est favorisé aux dépens d’un autre. Les meilleures universités chinoises forment une partie des meilleurs étudiants à l’échelle mondiale. Ces étudiants voudront, cependant, effectuer leur master ou leur doctorat à l’étranger, afin de bénéficier d’une expérience qui leur apportera un savoir-être différent. Du reste, le régime politique de la chine est très difficile à définir aujourd’hui sur un plan politique et culturel. La chine bénéficie d’un passé puissant et d’une culture de l’étude et du savoir spécifique. La réponse à cette question n’est donc pas proprement politique.
DE LA SALLE. – Quelle place est accordée au savoir-être dans les grandes écoles d’ingénieurs françaises ?
JEAN-MICHEL BLANQUER. – Le savoir-être des ingénieurs dépend de ce qu’ils ont expérimenté dans le système scolaire auparavant. Par ailleurs, l’originalité de la pensée et l’inventivité sont valorisées, alors que le système français est souvent critiqué pour être conformiste et ne pas permettre le droit à l’erreur. La culture générale et la capacité à s’interroger sur le monde, acquises avant la spécialisation, sont probablement des éléments de valeur ajoutée, en complément des compétences mathématiques. En France, nous avons aussi une manière différente de former nos ingénieurs, davantage comme des scientifiques pouvant répondre à des problèmes complexes que comme des techniciens.
DE LA SALLE. – Les Français ont une approche du leadership différente de celle d’autres pays. Les Français se sentent plus libres par rapport à la hiérarchie et plus communicatifs. Dans le même temps, le sens de la responsabilité dans leur fonction leur fait, parfois, défaut.
BENOÎT VERMANDER. – La question des valeurs qui traversent les savoirs est fondamentale. Les valeurs communiquées au travers des savoirs permettent de rendre ces savoirs partageables. Ainsi, à propos du leadership, à partir du moment où l’on conserve une certaine liberté par rapport à l’ordre donné et où chacun prend sa responsabilité, le partage de savoirs techniques ou pratiques va être facilité. Entre le savoir et son partage se situe notre système de valeurs.
ROGER-FRANÇOIS GAUTHIER. – Quand on s’interroge sur le succès des pays asiatiques, il ne faut pas oublier d’indiquer que, dans le cadre des cours de soutien payants dispensés le soir, les savoirs sont très fortement commercialisés. La marchandisation des savoirs constitue un problème, notamment au Japon, en Corée, au Viêtnam et en Chine. Le chercheur Mark Bray y voit le problème majeur de l’éducation au XXIe siècle. Les professeurs, mal rémunérés dans le cadre des journées normales de classe, préfèrent transmettre les savoirs fondamentaux lors des cours particuliers. Une telle dissection et commercialisation des savoirs va à l’encontre de l’idée de partage.
BENOÎT VERMANDER. – À Shanghai, le système fonctionne différemment grâce à une réforme qui a intégré une rémunération très satisfaisante pour les professeurs des écoles secondaires. La hiérarchie des lycées peut, comme en France, jouer dans le partage des savoirs. Être inscrit dans un bon lycée, donc payant, permet d’éviter de suivre des cours de soutien. La question de la marchandisation des savoirs se complexifie donc, même en Asie.